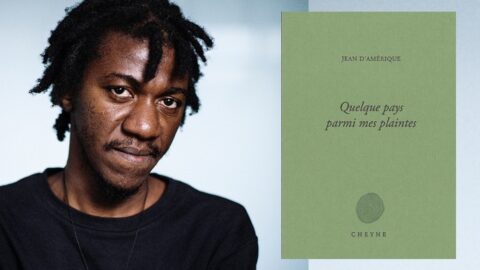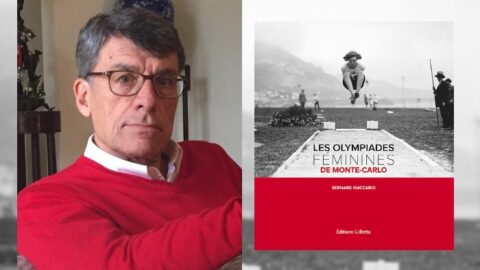Le crowdfunding culturel, vecteur d’émancipation des artistes et de démocratisation de la culture ? Pas sûr, selon Jacob Matthews, qui rappelle que derrière une idéologie pseudo-collaborative, les plateformes numériques de financement participatif appartiennent à l’économie capitaliste.
« Reprenons le pouvoir sur notre argent », « Libérons la créativité ! », « Créons un univers et une culture qui nous ressemblent » : c’est la promesse des principales plateformes numériques de financement participatif, du géant américain Kickstarter aux leaders français Ulule et KissKissBankBank, tous très actifs dans le secteur culturel. Alternative ou complément à la billetterie, aux aides publiques ou au mécénat d’entreprises privées, ce financement participatif de la culture en ligne, ou crowdfunding culturel, permet à des « porteurs de projets » (artistes, auteurs, associations, musées…) de récolter des fonds auprès des internautes, qui reçoivent des contreparties en nature en échange de leur contribution financière. Les fonds levés par ce biais doublent chaque année depuis 2011. Au total, plus de 4 000 milliards de dollars ont été collectés depuis la fondation des premières plateformes de crowdfunding. Sur ces transactions, les entreprises privées qui gèrent les plateformes récupèrent 5 à 8 % de marge.
| Lire aussi : Financement participatif : graal ou piège pour la culture ? |
Bio express
Coauteur de l’essai « la Culture par les foules ? » (2014), Jacob T. Matthews est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris-8. Ses travaux s’inscrivent au croisement de la théorie critique et de la socio-économie des industries de la culture et de la communication. Il s’intéresse aujourd’hui plus particulièrement au développement des plateformes d’intermédiation numérique dans les pays des Suds.
L’émergence et la multiplication depuis dix ans des plateformes de crowdfunding culturel est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la culture ?
Le financement participatif de la culture n’a en soi rien de condamnable, en termes éthiques ou autres. Mais il faut replacer les plateformes numériques de crowdfunding au sein d’évolutions socio-économiques qui les dépassent : leur modèle économique actuel est une sorte d’annexe du système capitaliste. Et en ce qui concerne la diversité culturelle, les conditions de travail dans le secteur et l’état du débat démocratique autour de la question, il n’y a selon moi aucune raison de célébrer l’émergence de ces plateformes.
Dans le cas français, le crowdfunding culturel est-il voué à pallier ou remplacer le financement public de la culture ?
Beaucoup de dirigeants de plateformes de crowdfunding sont très clairement hostiles au financement public, accusé d’être bureaucratique, partial, etc. Vis-à-vis de cela, le crowdfunding apparaît donc comme un vecteur de démocratisation. Les acteurs institutionnels de la culture (État, régions, musées…) sont eux-mêmes enthousiastes à l’idée qu’on remplace les financements publics par des initiatives de financement participatif. Mais ce dont on se rend moins compte, c’est que ce « mécénat déconcentré » précarise de plus en plus les travailleurs créatifs et culturels. Pour eux, le crowdfunding constitue à la fois une opportunité et une contrainte.
En quoi est-il différent de lancer une campagne de crowdfunding et de construire un dossier de financement pour la Drac (Direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du ministère de la Culture) ?
Il y a d’abord une plus grande incertitude, et un certain investissement émotionnel, une charge d’anxiété, qui pèsent sur l’individu créateur. Quand la campagne de crowdfunding est lancée, on dispose d’un temps limité (généralement plusieurs semaines). Il y a ensuite une injonction contraignante au marketing et à la communication : surveiller les indicateurs, relancer les donateurs potentiels, optimiser sa visibilité sur les réseaux sociaux… Et ce chaque jour, voire plusieurs fois par jour, surtout à la fin de la campagne [où 20 % des fonds sont collectés, ndlr]. Puis vient la mise en place des contreparties, leur envoi sous forme de colis, etc. Soit un ensemble de tâches annexes, lassantes et chronophages, qui s’ajoutent au processus créatif. Et un temps auquel les artistes n’avaient souvent pas réfléchi.
« Le grand bluff du web est d’imaginer qu’il puisse encore exister des technologies neutres. C’est un reliquat de l’Internet des premiers temps, et un discours tout à fait critiquable, voire une forme d’escroquerie. »
Cet auto-entrepreneuriat des artistes ne masque-t-il pas le rôle d’intermédiaire des plateformes numériques de crowdfunding ?
Aujourd’hui, la manière dont les plateformes de crowdfunding valorisent et produisent du capital est fondée sur leur position d’intermédiaire. Si on revient au sens étymologique, la plateforme est l’endroit où s’échangent les marchandises, où différents intermédiaires se rejoignent et où la transaction se conclut. Dans le cas des plateformes de crowdfunding, qui sont des entreprises privées, l’objectif est de faire interagir les logiques de différents acteurs autour d’une langue commune : des porteurs de projets individuels, des organisations caritatives, des pouvoirs publics, des donateurs, des marques, de grandes entreprises… Soit des groupes et des individus de taille et de force très différentes. Or, l’échange qui a lieu nous semble asymétrique vis-à-vis de certains de ces acteurs : en l’occurrence, les porteurs de projets et les donateurs, sans qu’ils s’en aperçoivent forcément. Car il s’agit de propager le discours et l’idéologie de ceux qui sont en position de force dans cet échange.
De quelle idéologie s’agit-il ?
L’élément principal est une valorisation de la responsabilisation individuelle : la réussite ou l’échec reposent sur une seule personne, le « porteur de projet ». Il y a toujours eu dans l’industrie culturelle une tension entre la standardisation et l’autonomie de l’artiste. Or de manière assez perfide, dans le crowdfunding culturel tel qu’il se développe aujourd’hui, l’autonomie de l’artiste est mise au service d’une rentabilité financière, qui est aussi la sienne, en tant qu’artiste. Au fond, la financiarisation qui touche énormément de secteurs de l’économie descend ici jusque dans l’intimité de la création artistique.
Comme le dit Vincent Ricordeau, cofondateur et PDG de la plateforme de crowdfunding française KissKissBankBank, soit on se plie à ce système, et l’on fait partie d’une « famille créative artistique et innovante », soit on n’y a pas sa place. Il y a quelque chose de terrifiant dans ce discours : si vous acceptez, vous faites partie des « winners » [gagnants, ndlr], sinon, vous faites partie des « losers » [perdants, ndlr]. Ce qui est au fond une condamnation de beaucoup de créateurs artistiques qui ne souhaitent pas que leur travail soit parasité par ce système.
C’est à mille lieues de ce que véhicule le concept d’économie collaborative régulièrement mis en avant…
C’est du fait de contraintes structurelles que certains acteurs tiennent ce discours. Sur le plan économique, si certaines plateformes affichent des marges intéressantes, ces entreprises sont aussi dans une situation de précarité. Elles ne sont pas la propriété de grands groupes, et dépendent souvent de fonds d’investissement, de « business angels » [« investisseur providentiel » soutenant les entreprises innovantes, ndlr] et d’annonceurs publicitaires envers lesquels elles ont une obligation de rentabilité financière. Ce qui pèse fortement sur leur stratégie, y compris du point de vue des travailleurs internes, avec un turnover de stagiaires et un recours au travail free-lance importants.
« Ces entreprises ont tout intérêt à diffuser l’idée de l’économie collaborative et du partage. Toutes ces références à un logiciel collectiviste, socialiste ou communiste, loin du logiciel capitaliste, sont intéressantes pour accomplir leur besogne. »
Derrière ces discours, il y a un objectif d’ingénierie sociale [visant à modifier à grande échelle certains comportements de groupes sociaux, ndlr]. Un indice intéressant est que les dirigeants de plateformes de crowdfunding passent beaucoup de temps à organiser des conférences, écrire des livres, ou à intervenir dans les universités, les discussions publiques et les médias… Ils produisent beaucoup de discours, et ont intérêt à ce qu’il soit relayé par l’État ou des acteurs politiques.
C’est une analyse assez cynique.
Je ne tiens pas un discours moralisateur sur ces personnes. Mais tant que des technologies de ce type seront mises au service de la propriété et de l’appropriation privées, ça bloquera. Il y a de bonnes volontés, balbutiantes certes, mais qui cherchent des alternatives à cette financiarisation. C’est très faible, par rapport à l’activité humaine déployée pour appuyer toutes les plateformes existantes. Du côté des pouvoirs publics, ce qu’on observe, c’est une délégation, un « laisser-faire », voire un encouragement. La question est donc : comment en limiter les dégâts ? Selon nous, cela devrait donner lieu à une intervention publique nettement plus courageuse que celle qu’on a connue jusque-là, au niveau national, voire international.
Comment voyez-vous l’avenir du crowdfunding, et plus généralement de l’économie collaborative numérique ?
Je suis confiant, même si les conditions immédiates, politiques, ne sont pas encore réunies. À présent, il faut aller sur le terrain social. Paradoxalement, l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République [qui promet de « sécuriser et accompagner » le secteur du financement participatif, reprenant en cela plusieurs des revendications énoncées par les opérateurs des plateformes de crowdfunding hexagonales, ndlr] peut avoir un effet d’aubaine pour renforcer les luttes et la réflexion à propos du travail sur les plateformes numériques.
Si je vais plus loin que mon statut d’observateur pour m’aventurer sur le terrain de la préconisation, on peut tout à fait imaginer des plateformes de crowdfunding impliquant directement les pouvoirs publics. Je suis peut-être utopiste, mais il n’est pas interdit de penser que l’Internet puisse être géré par l’Organisation des Nations unies, et qu’on puisse collectivement décider d’une appropriation publique de l’ensemble de ces plateformes numériques, dans tous les secteurs, y compris BlaBlaCar, Uber, etc. Afin que le modèle économique de la finance participative ne soit plus celui de la valorisation de capitaux privés, mais celui du service public à but non lucratif. Toute la question de l’économie collaborative est là.
 « La Culture par les foules ? Le crowdfunding et le crowdsourcing en question », Jacob T. Matthews, Vincent Rouzé et Jérémy Vachet, MkF Éditions, 2014, 64 p., 10 €. « La Culture par les foules ? Le crowdfunding et le crowdsourcing en question », Jacob T. Matthews, Vincent Rouzé et Jérémy Vachet, MkF Éditions, 2014, 64 p., 10 €.
Lisez le livre papier et approfondissez en numérique : l’achat d’un volume papier donne accès à ses « suites numériques », une version étoffée téléchargeable avec le code inclus en fin d’ouvrage. |