
Hubert Félix Thiéfaine ©Yann Orhan
Dans son dix-septième album, Stratégie de l’Inespoir, Hubert Félix Thiéfaine évoque l’inhumanité des réseaux sociaux, la barbarie stalinienne et rend hommage à l’œuvre de Céline. Libre et érudit, après quarante ans de scène, le Jurassien reste fidèle à lui-même. Il parle de ses fragilités et de son refuge, le silence.
C’est votre dix-septième album, c’est pas mal pour quelqu’un qui a longtemps été boudé par le show-biz et les médias…
Hubert Félix Thiéfaine : Mais pas par le public. Je fais cela depuis quarante ans. J’ai galéré. Je n’ai pas mangé tous les jours à ma faim, parfois des semaines entières. L’important, c’était de vivre ce rêve d’enfants. Je n’avais pas d’autres choix, autrement je n’aurais pas survécu. C’était pour occuper l’attente… (Rires.) J’ai toujours été attiré par le grand vide. Rimbaud dit : « Être poète, c’est un métier ». Alors, après plein de petits boulots, en 73, j’ai décidé de faire de la chanson à temps complet. Il fallait que j’aie mes jours et mes nuits pour écrire, corriger, jouer. Et vers 1980-81, j’avais déjà un public. D’ailleurs, les médias s’interrogeaient en me voyant à l’Olympia : il y avait deux milles personnes à l’intérieur et deux milles autres dehors qui n’ont pas pu rentrer. Ils se disaient, « c’est bizarre, ce mec, on ne sait même pas comment s’écrit son nom ».
Vous dites que vous venez d’un milieu prolétaire ?
Je viens d’une cité ouvrière, je le revendique. Mon père était typographe, ma mère était femme au foyer avec six enfants, avant d’être femme de ménage. C’était un milieu très modeste, ouvrier et catholique pratiquant. Mes parents étaient du style à dire que ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on doit être sale. À l’époque, quand j’étais étudiant en fac de droit et de lettres, on était 3% à être fils d’ouvriers.
Qu’est-ce que ce milieu vous a légué, transmis ?
C’est une question très épaisse ! (Silence.) Disons que j’ai eu cette enfance très heureuse au sein de ma famille, mais dès que je sortais de chez moi, c’était un cauchemar ! Je crois que je continue à le traîner. Je n’étais pas du tout adapté à l’école mais, compte tenu de la demande familiale qui était de s’élever, je culpabilisais d’être un rêveur. J’ai été à l’école catholique et laïque et j’ai beaucoup souffert dans cette dernière. Il y avait à l’époque des professeurs qui savaient que l’on venait d’un milieu pratiquant alors qu’ils étaient de gauche, voire d’extrême gauche. Ils en profitaient pour transformer le gosse en martyr. C’est pourquoi j’ai écrit dans cet album, Résilience Zéro. Et pour fuir ce cauchemar, je suis rentré carrément en pension dans un petit séminaire. Mais cela s’est inversé. On me disait tout le temps « Ici, on n’est pas à l’école laïque ». Je n’y suis pas resté non plus… (Rires.) J’ai un peu de mal dans tous les milieux. Mais ce que je retiens de positif, c’est l’autodiscipline. Vous voyez, je fais beaucoup de télé en ce moment je le fais parce qu’on m’a appris à supporter les choses douloureuses… (Rires.)

Hubert Félix Thiéfaine©YannOrhan
Au point de vous retirer dans le Jura et d’habiter dans une forêt ?
Les sorties dans le monde social me déchirent profondément. J’ai besoin de rentrer chez moi pour sortir les aiguilles et recoudre les plaies. J’ai besoin d’être ailleurs que dans la société, et puis je m’entends bien avec ma solitude. Au petit Séminaire, on était condamné au silence, car on pouvait tout fouiller, dans nos pupitres, nos armoires, donc il fallait tout mettre dans sa tête. La chanson était la cache idéale !
Qu’est-ce que vous reprochez à ce monde, à notre monde ? Dans la chanson Médiocratie, vous égratignez les médias, les réseaux sociaux…
Ce que je leur reproche c’est leur médiocrité. C’est terrible ce que l’on peut lire sur les réseaux sociaux. Ce n’est même pas des choses engagées. Je vais sur Internet pour l’encyclopédie. Je n’y vais pas pour écrire que, ce matin, j’ai mangé une pomme ! Il y en a qui le font. Je ne vois pas l’intérêt. Je parle des gens qui s’emmerdent et qui ne savent pas profiter de leur temps. Ce que j’ai aimé chez Nietzsche, c’est cette conception de se dépasser tous les jours. Il y’a tellement de questions que l’on se pose et nous avons tellement peu de réponses que cela mérite tout de même que l’on essaie d’élargir ses connaissances, son univers. Et son esprit aussi.
Dans la chanson Karaganda (Camp 99), vous dénoncez également un certain aveuglement de la part d’Aragon et d’Elsa Triolet dans leur soutien au communisme. Et dans Retour à Célénigrad, vous rendez hommage à Céline. On ne comprend pas votre position.
Je vais essayer d’être clair. La politique ne m’intéresse pas. J’aime l’être humain et ses paradoxes. Je suis libre de pouvoir lire Drieu Larochelle ou les pamphlets de Céline. Je suis un fan de la littérature Célinienne, et d’ailleurs je les trouve abominables ces pamphlets. À la fin des années cinquante, il dit lui-même qu’il n’en était pas fier de ces écrits. Sauf peut-être de Mea Culpa, qui est justement un pamphlet anti-communiste, parce qu’il revient de chez Staline. Lui, comme Georges Orwell, ont compris ce qui se passait là-bas. C’était en 1936, les grandes épurations commençaient. Dans le même bus, il y avait Elsa Triolet (la première traductrice de Voyage au Bout de la Nuit) et Aragon, et eux, ils n’ont rien vu. Ils ont pratiqué le communisme avec des œillères. Là où je veux en revenir, que cela soit Hitler ou Staline, c’est la facette de la même barbarie. C’est pour cela que j’ai écrit Karangada. Il faut se battre contre les extrêmes, surtout aujourd’hui.
Vous n’aimez pas la politique parce que vous considérez qu’elle n’est pas compatible avec l’art ?
Un artiste doit être en dehors de cela. Il doit aller chercher l’universel, l’infini. Il ne peut pas jouer avec le présent, faire du bricolage domestique.
Vos textes sont denses, presque inaccessibles, c’est pour garder un certain mystère ou pour cibler un certain public ?
Je me réfère à la peinture et au cinéma d’art et d’essai. Je joue sur l’ombre et la lumière. Et l’ombre est très importante, parce que, justement, elle crée un mystère. Le spectateur est obligé de travailler un peu pour savoir ce qui se cache derrière le rideau. J’utilise des mots arcanes, beaucoup de labyrinthes. J’aime rendre ce côté onirique et cet inconscient collectif. Étrangement, beaucoup de gens se retrouvent dans mes chansons. Par exemple, Le Dingue et Les Paumés : à sa sortie en 1982, les journalistes disaient que c’était incompréhensible. Je continue à chanter ce titre car le public le chante avec moi. L’art n’est pas fait pour être compris, c’est fait pour être assimilé.
 Pour acheter les places des concert de Hubert-Félix Thiéfaine, rendez-vous sur le site ccas.fr, identifiez-vous à l’aide de votre NIA et de votre mot de passe, puis cliquez sur l’espace Culture et Loisirs, ou, une fois identifié, suivez ce lien
Pour acheter les places des concert de Hubert-Félix Thiéfaine, rendez-vous sur le site ccas.fr, identifiez-vous à l’aide de votre NIA et de votre mot de passe, puis cliquez sur l’espace Culture et Loisirs, ou, une fois identifié, suivez ce lien




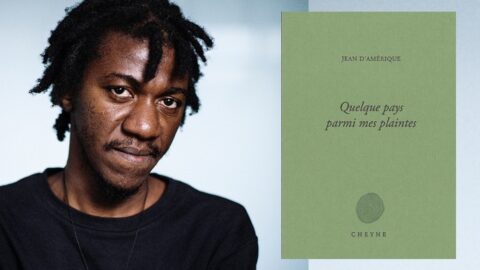


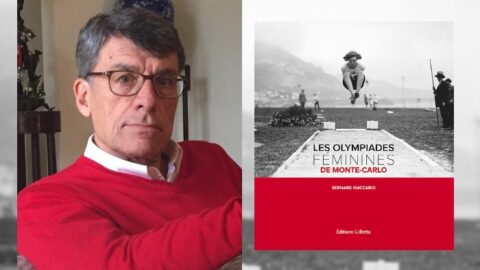


Thiefaine est un grand artiste son dernier album est une merveille d art et de poésie. J’aimerais le rencontrer un jour tout comme j’aurais aimé rencontrer Rimbaud. Je suis fan de lui sans être fanatique. Je me suis rendu à plusieurs de ses concerts mais ce que j’ai préféré c’est le jour où il est venu à charleville mézières pour l’inauguration du nouveau musée Rimbaud appelé la maison des ailleurs. Ce jour-là il a interprété sa chanson la jambe de Rimbaud sans me quitter du regard! J’en ai eu les larmes aux yeux. Hubert a dû voir dans mes yeux que l’on a la même sensibilité poétique. Et je suis reparti avec un masque de Rimbaud dédicacé par Hubert que j’ai toujours. Mon rêve est de le rencontrer en toute simplicité.
Bonjour, plein de réalisme ce monsieur Thiéfaine.
Ses œuvres doivent être passionnantes
Cordialement
Claude