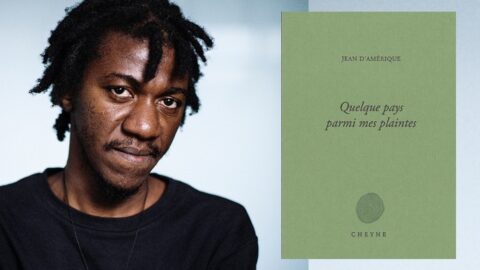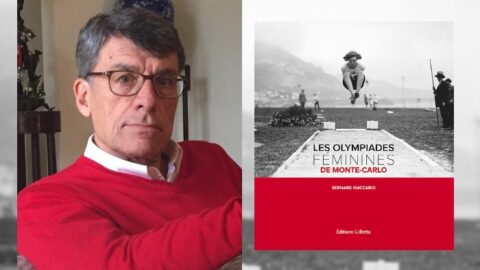Actrice et réalisatrice française aux origines algéro-palestiniennes, Lina Soualem est la marraine de l’édition 2024 de Visions Sociales. Ses deux films, « Leur Algérie » (2020) et « Bye bye Tibériade » (2024), l’un et l’autre à l’affiche du festival, racontent l’exil, la transmission, la mémoire individuelle et collective. Des œuvres bouleversantes à vocation universelle.
Vos deux films abordent des sujets délicats : « Leur Algérie » raconte la séparation de vos grands-parents paternels, après soixante-deux ans de mariage. « Bye bye Tibériade » parle de l’expulsion des Palestiniens de leur terre à travers l’histoire des femmes de votre famille maternelle. Comment votre démarche a-t-elle été perçue dans votre famille ?
Lina Soualem : J’ai toujours été accueillie de manière très chaleureuse et naturelle, malgré quelques résistances. Personne ne m’a jamais dit : « Ne me filme pas. » Pour ma famille, il n’était pas si étonnant qu’avec deux parents comédiens [Hiam Abbass et Zinedine Soualem, ndlr] j’arrive avec une caméra.
Quand j’ai commencé à filmer « Leur Algérie », j’avais un peu peur de me confronter au silence de mon grand-père. Mais ce silence n’était pas un rejet : il existait avec ou sans caméra. Ma mère était un peu résistante au départ : il lui était difficile de s’adresser à une caméra documentaire, elle qui est habituée aux tournages de fiction. Et il m’était difficile de m’adresser à ma mère en tant que femme et réalisatrice, et pas seulement en tant que fille. Il nous a donc fallu un temps pour trouver notre équilibre.
Dans votre famille paternelle, la transmission se fait avec réticence, alors qu’on perçoit chez les femmes de votre famille maternelle une véritable urgence à raconter leur histoire. Pourquoi cette différence selon vous ?
Lorsque j’ai commencé à travailler sur « Leur Algérie », j’ai compris qu’il y avait beaucoup de choses qui allaient rester dans le non-dit. Ce silence ne cachait pas de secrets de famille mais plutôt une douleur, celle du déracinement. Comme si, pour survivre, la famille s’était réfugiée dans ce silence qui était une manière de se protéger et de protéger les descendants.
Côté maternel, il y avait plutôt la nécessité de continuer à exister, à travers la transmission de l’histoire, dans un contexte palestinien où cette histoire n’est pas reconnue.
Dans « Bye bye Tibériade », vous avez choisi de parler de la Palestine à travers les figures de femmes fortes de votre famille. Diriez-vous que vous avez fait un documentaire féministe ?
Je laisse la liberté à chaque spectateur d’interpréter le propos comme il le sent, selon son combat personnel, sa nécessité de se définir. Mais je ne veux pas imposer aux femmes de ma famille une vision qui ne leur appartient pas. Leur liberté se vit à travers leur parcours.
Je ne veux pas définir les femmes de ma famille parce que, pour moi, elles ne sont pas uniques. On a tendance à opposer deux visions des femmes du Moyen-Orient : la femme très traditionnelle et conservatrice qui va reproduire le modèle patriarcal versus la femme très libre qui va quitter la famille, pour embrasser un modèle de « liberté » occidental.
Alors que la plupart de ces femmes ont des espaces de liberté dans ces contextes-là et sont en même temps attachées à certaines valeurs traditionnelles et à leur famille. Ce que je trouve intéressant, c’est de leur donner le droit à cette complexité. Vous êtes née du départ de votre mère pour l’Europe.
Comment vivez-vous le fait d’être « née d’une rupture entre deux mondes », pour vous citer ?
Tout l’enjeu pour moi est de pouvoir trouver ma place dans des espaces intermédiaires, puisque je navigue entre plusieurs identités, histoires et mémoires. À travers mon travail, j’essaie de rassembler ces morceaux de puzzle.
C’est tout un cheminement : il me faut accepter de transformer ces espaces intermédiaires, dans lesquels j’ai l’impression de perdre l’équilibre, en un espace de liberté qui est le mien, dans lequel je peux me construire comme j’en ai envie, sans rentrer dans les perceptions que les autres peuvent avoir de moi.
Considérez-vous que votre film redonne une voix aux Palestiniens, surtout dans le contexte qu’on connaît, notamment depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier ?
Le film n’est en aucun cas l’histoire des Palestiniens. Souvent ils sont désignés comme une masse homogène : c’est stigmatisant et déshumanisant. Il s’agit surtout de permettre à des parcours de vie uniques d’exister dans leur authenticité. Parce que, pour moi, les mémoires individuelles, dans le contexte d’une histoire collective qui n’est pas reconnue, contribuent à enrichir la mémoire collective.
C’est une manière de contribuer à une forme d’écriture de l’Histoire plus générale, mais sans se substituer à elle, ni prétendre représenter qui que ce soit. L’important est de pouvoir, à travers ces histoires, transmettre, pour que d’autres personnes puissent se reconnaître. Ce sont des choses qui touchent tout le monde.
Visions Sociales, c’est à la Napoule et en ligne
En parallèle du festival Visions Sociales, qui se déroule du 18 au 25 mai dans les Alpes-Maritimes, la Médiathèque vous offre en exclusivité une sélection de films en accès libre, à voir durant le festival. Réservez vos soirées cinéma, certains ne sont visibles que durant 48 heures ! Et pour patienter, la Médiathèque vous propose une rétrospective de films projetés lors des éditions précédentes, en accès libre durant tout le mois de mai.
Voir la programmation de Visions Sociales numérique Voir la rétrospective en accès libre
► Connectez-vous à votre compte sur ccas.fr (NIA + mot de passe) pour accéder aux contenus de la Médiathèque.
Tags: Cinéma Droits des femmes Guerre d’Algérie Palestine Vidéo Visions sociales
![[Vidéo] Lina Soualem (Visions Sociales) : "Je navigue entre plusieurs identités, histoires et mémoires" | Journal des Activités Sociales de l'énergie Sélection Visions Sociales 2024, films programmés lors des éditions précédentes, en accès libre sur la Médiathèque](https://journal-qualif.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2024/05/ccas.mediatheques.fr-Visions-Sociales-numeriques-2024-Mediatheque-des-Activites-Sociales.png)