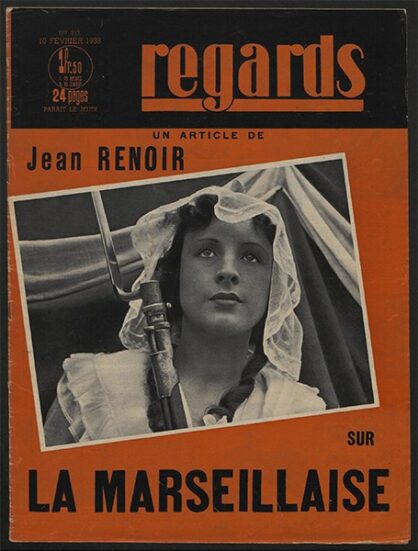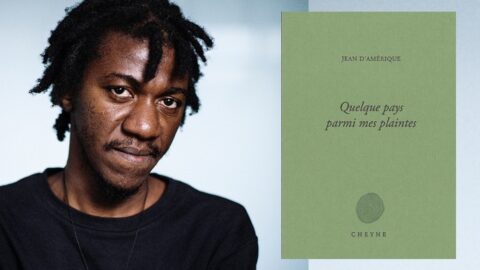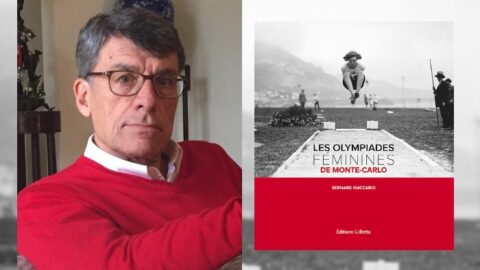Manifestation pour la sauvegarde du cinéma français et contre les accords Blum-Byrnes à Paris, le 4 janvier 1948. De gauche à droite : Jean Marais, Simone Signoret et Roger Pigaut. ©Pigiste/AFP
Avec « l’Écran rouge », Tangui Perron revient sur l’enfance méconnue du cinéma français. Du Front populaire à la Libération, une histoire à la fois artistique et militante, à laquelle le 7e art français, l’un des plus vivants au monde, doit beaucoup.
La photographie de couverture de votre livre montre, entre autres, Jean Marais et Madeleine Sologne manifestant pour le cinéma français. Quel est son contexte ?
Celui d’une manifestation syndicale, professionnelle et populaire, sur les grands boulevards à Paris, pour la défense du cinéma français, le 4 janvier 1948. Cette manifestation a rassemblé des milliers d’ouvriers du film, de techniciens, de réalisateurs et de producteurs, d’acteurs et de spectateurs rassemblé·es par les comités de défense du cinéma. Cette photo est restée longtemps dans les mémoires et symbolise encore l’unité de la profession et l’implication du public.
Qu’est-ce qui explique l’implication d’autant de protagonistes à tous les échelons du milieu du cinéma ?
Sans doute un sentiment d’urgence et une politique syndicale unitaire remarquable. Le cinéma français est alors en crise et se sent légitimement menacé par l’arrivée massive de films américains favorisée par une annexe des accords Blum-Byrnes de 1946, accords gouvernementaux qui renégociaient la dette de la France vis-à-vis des États-Unis, dans le cadre de la reconstruction du pays après la guerre.
La profession s’est regroupée avec la Fédération du spectacle CGT alors très implantée dans les milieux du cinéma. Le Parti communiste a mobilisé les spectateurs et les spectatrices. Cette manifestation n’a pas été le point d’orgue mais plutôt le point de départ d’une intense mobilisation dans les cinémas et les ciné-clubs et au sein du Parlement.
Cela a abouti à une révision des accords Blum-Byrnes dans un sens un peu plus favorable au cinéma français et surtout au vote, à l’unanimité du Parlement, d’une loi originale d’aide au cinéma. Cette loi votée en septembre 1948 et confirmée en 1953 puis pérennisée explique pour partie l’existence du cinéma français encore aujourd’hui. Une taxe prélevée sur l’achat de tous les billets de cinéma, quelle que soit l’origine des films, est ainsi réinvestie nationalement dans l’économie du cinéma. C’est un pilier, souvent envié dans les autres pays, de la diversité culturelle.
De g. à dr., les affiche de « La Bataille du rail » de René Clément (1946) et de « la Grande Illusion » de Jean Renoir (1937), et « la Marseillaise » à la une du magazine « Regards » (fév. 1938). Source : gallica.bnf.fr/BNF
Qui sont les Joyeux grévistes des studios de Boulogne-Billancourt ?
Là, nous ne sommes plus après-guerre mais avant, au moment du Front populaire, en 1936, quand les ouvrières et les ouvriers, les employées et les employés ont occupé, pour la première fois dans l’histoire sociale, leur lieu de travail. Cette grève a aussi été une joie.
Quel rôle joue le mouvement syndical dans la défense du cinéma pendant cette période ?
Le syndicalisme s’implante réellement dans les milieux du cinéma durant le Front populaire. Les ouvrières et les ouvriers du film sont les premier·ères à arracher une convention collective, suite aux occupations des studios et des labos de cinéma, en juin 1936. La Fédération du spectacle CGT se définit également durant cette période, rejointe par le syndicat des acteurs et celui des techniciens, indépendants jusque-là.
Pour la fédération – ce point est d’ailleurs défendu par le cinéaste Jean Renoir – l’amélioration des conditions de travail des ouvrier·ères et des technicien·nes du film est un gage de qualité des films. Par ailleurs, la grande production cinématographique est en crise depuis le milieu des années 1930. Pour la CGT, l’aventure collective de « la Marseillaise » de Jean Renoir (1938), sur laquelle ne travaillent que des ouvrier·ères et des technicien·nes syndiqué·es, est déjà le début d’une réponse à cette crise économique. Parallèlement, le gouvernement et le Parlement envisagent une refonte complète de l’administration du cinéma.
La plupart de ces réformes aboutiront après-guerre : développement d’une école du cinéma [l’Idhec, intégrée à la Fémis en 1986, ndlr], création du Centre national de la cinématographie (CNC) et du Festival de Cannes, lois d’aide de 1948 et 1953…
Les réalisateur·rices des deux premiers tiers du XXe siècle sont souvent en butte à la censure. Est-elle un frein à leur créativité ?
Bien sûr. C’est aussi un facteur favorisant l’autocensure et l’aliénation des publics privés de sujets sociaux, sociétaux et politiques. Néanmoins, la nécessité de contourner la censure – en empruntant les sentes de l’allégorie ou de la polysémie – peut, paradoxalement, stimuler la créativité. On le voit par exemple aujourd’hui dans le cinéma iranien, de grande qualité.
Pour l’histoire du cinéma durant les premiers tiers du XXe siècle, on peut dire, très schématiquement, que la censure a d’abord voulu interdire une critique de l’armée et du colonialisme et qu’elle s’est opposée à une vision trop directe de la sexualité et de la question sociale. L’Église a aussi agi pour interdire des films ou des séquences et pour empêcher ses fidèles de voir tel ou tel film.
Vous écrivez : « Sous le sable de la Croisette et la vanité des paillettes, il y a toujours un cœur rouge qui bat. » Pourquoi ?
Dans ce livre collectif, deux articles sont consacrés à l’existence du Festival de Cannes. L’historien Olivier Loubes montre par exemple très bien les origines des antifascismes qui président à la création du festival en 1939 (complètement prêt mais annulé in extremis à cause de l’entrée en guerre de la France). Après la Libération, en 1946 et surtout en 1947, c’est le mouvement ouvrier – la CGT et le PCF, très influents à l’époque – qui contribuent à cette renaissance.
Si les mondanités, les pressions diplomatiques ou le pouvoir de l’argent ont tôt pesé sur la destinée du festival, la politique ou le goût populaire pour le cinéma n’ont pas totalement disparu, pour autant, de la Croisette. 1968 et les années 1970 ont été de grandes années politiques du festival. Encore aujourd’hui, la présence de la Fédération du spectacle CGT au sein du conseil d’administration du Festival de Cannes, l’existence des cheminots cinéphiles ou l’excellente programmation au festival Visions sociales de la CCAS sont des indices de cette cinéphilie et de cette histoire sociale et syndicale.
Pour aller plus loin
 « L’Écran rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo »
« L’Écran rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo »
Sous la direction de Tangui Perron, Éditions de l’Atelier, 2018, 240 p., 30 euros.
Préface de Costa-Gavras, postface de Philippe Martinez.
Tags: Cinéma Festival de Cannes Syndicats Visions sociales